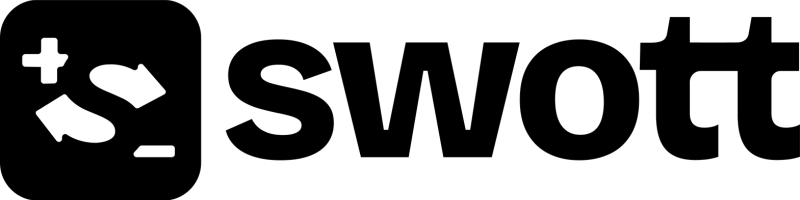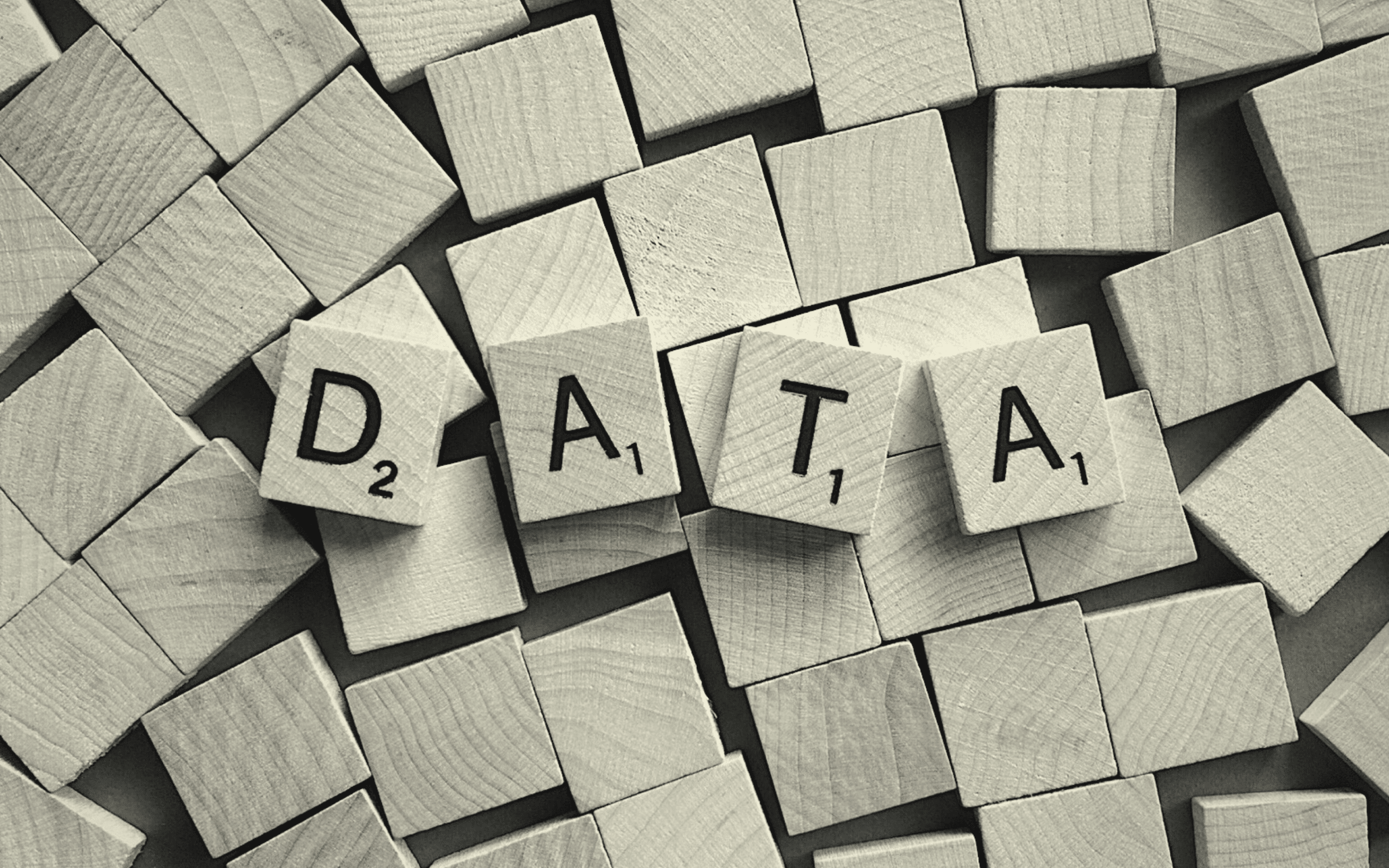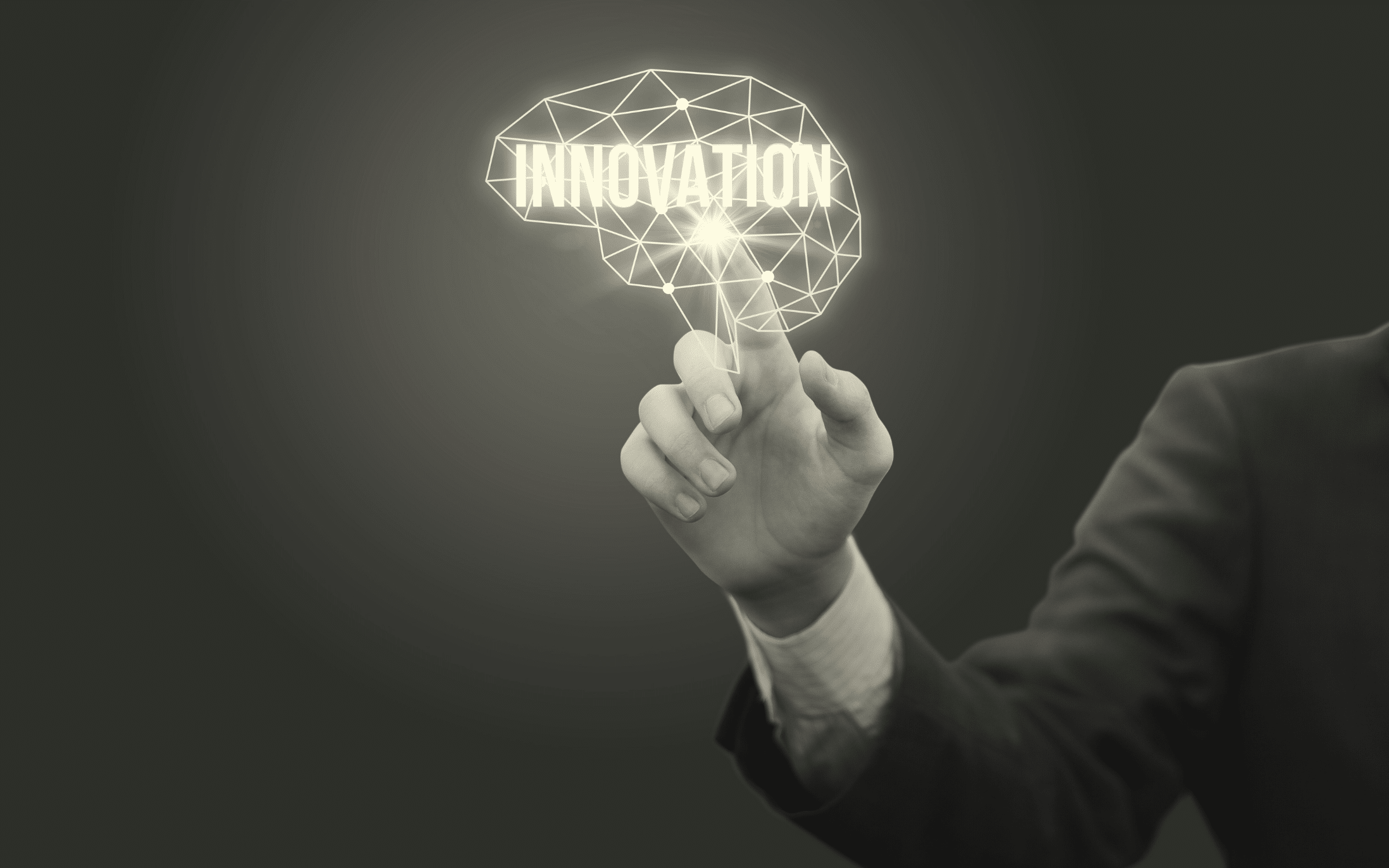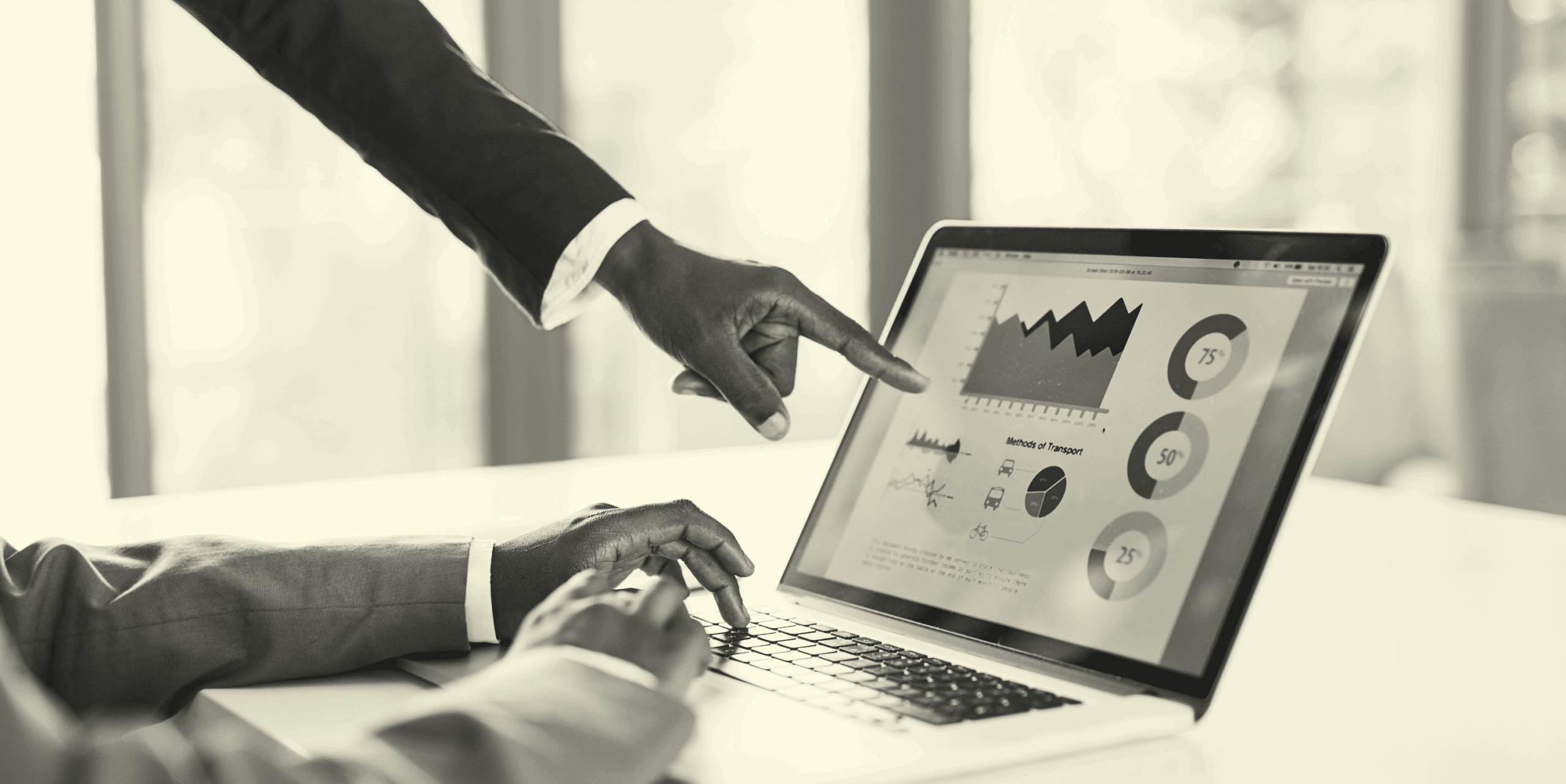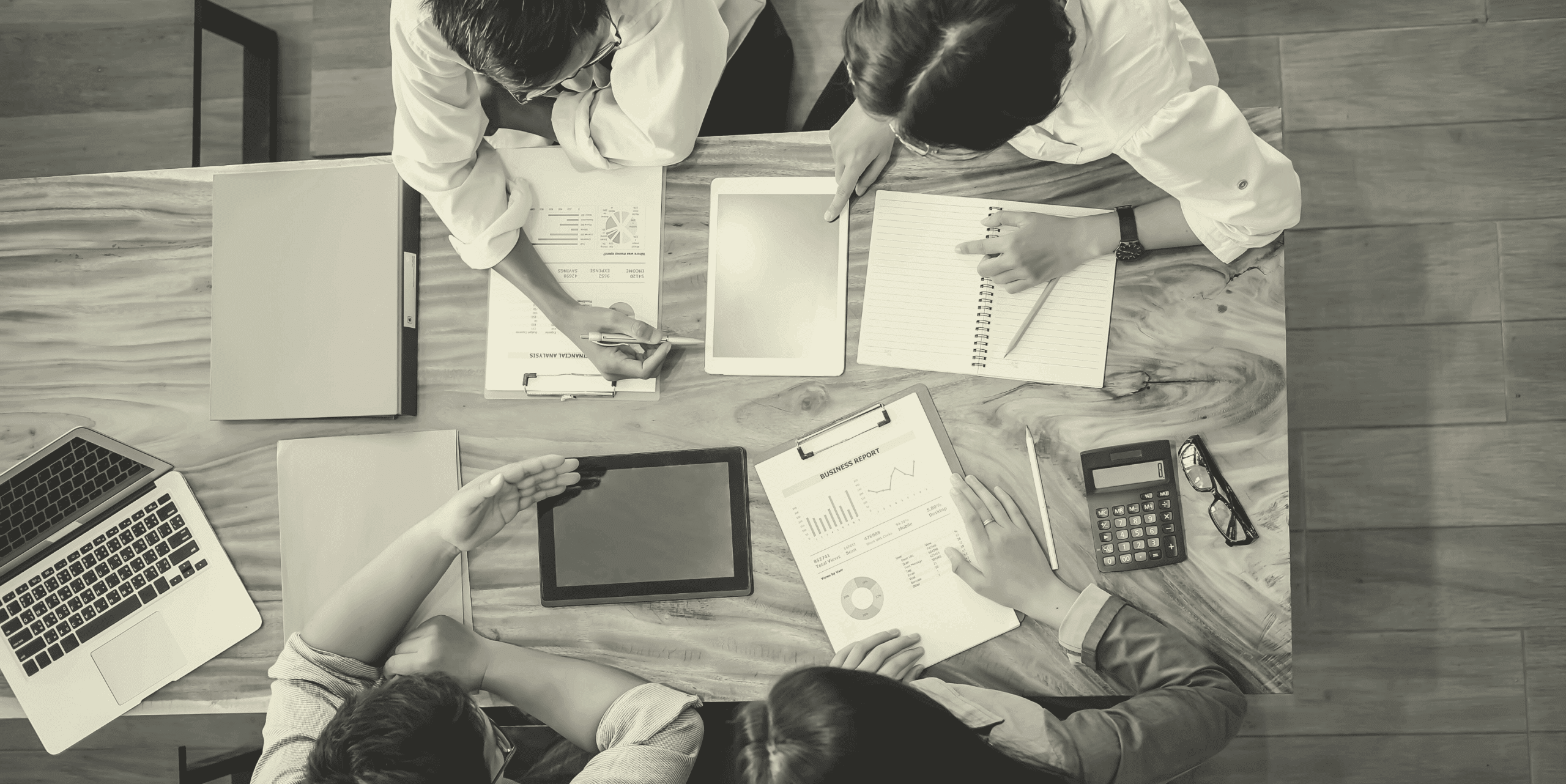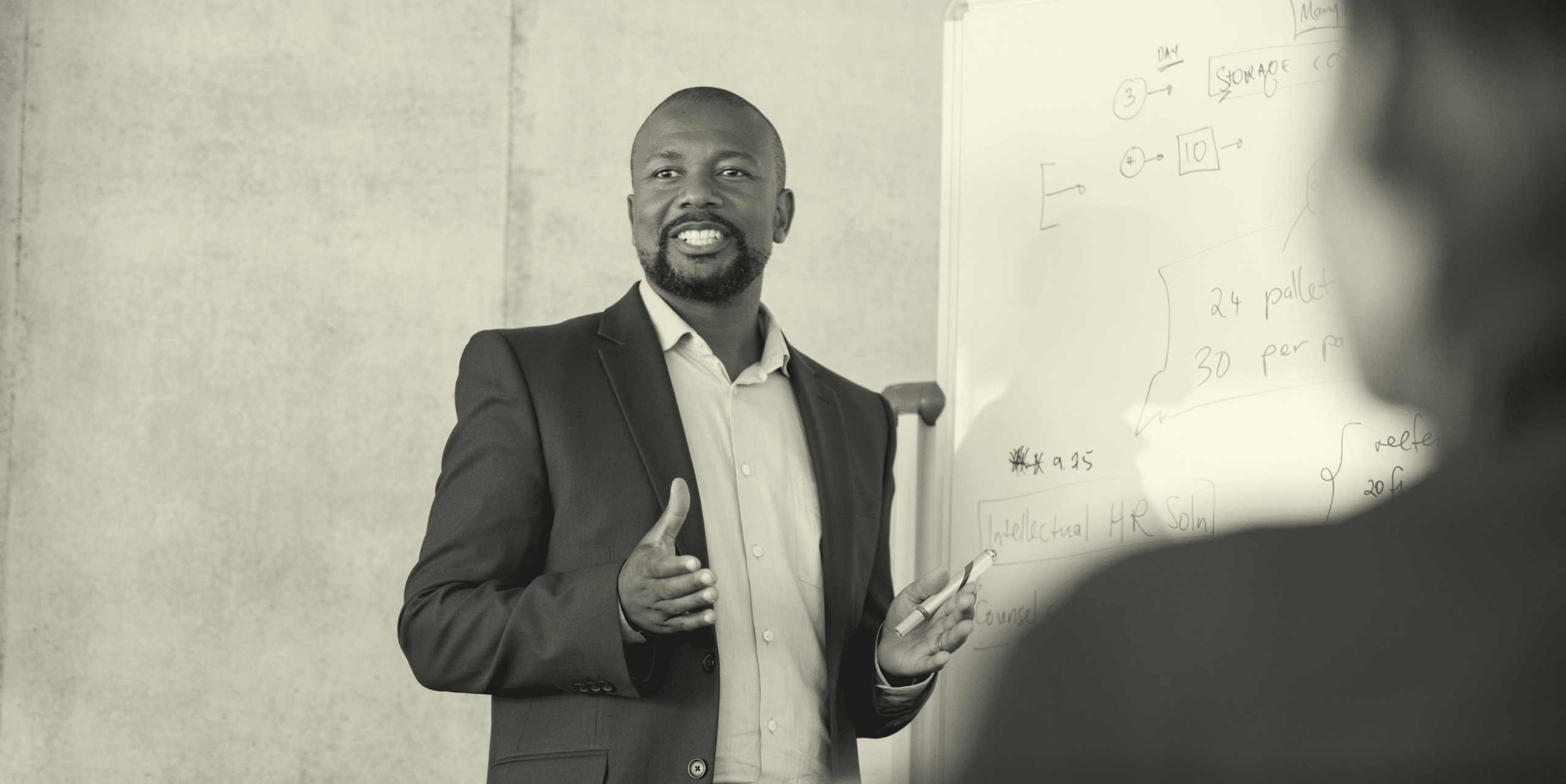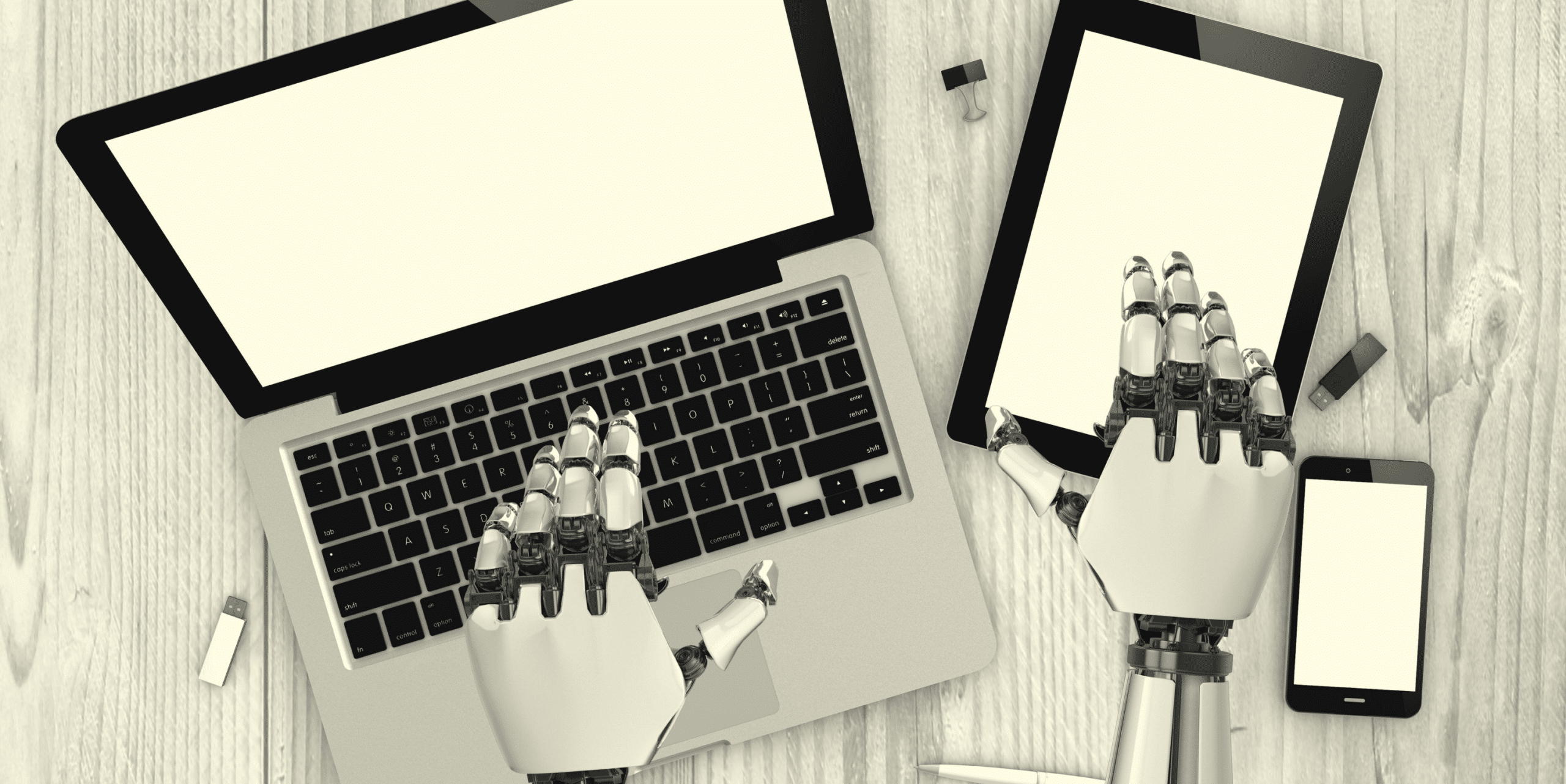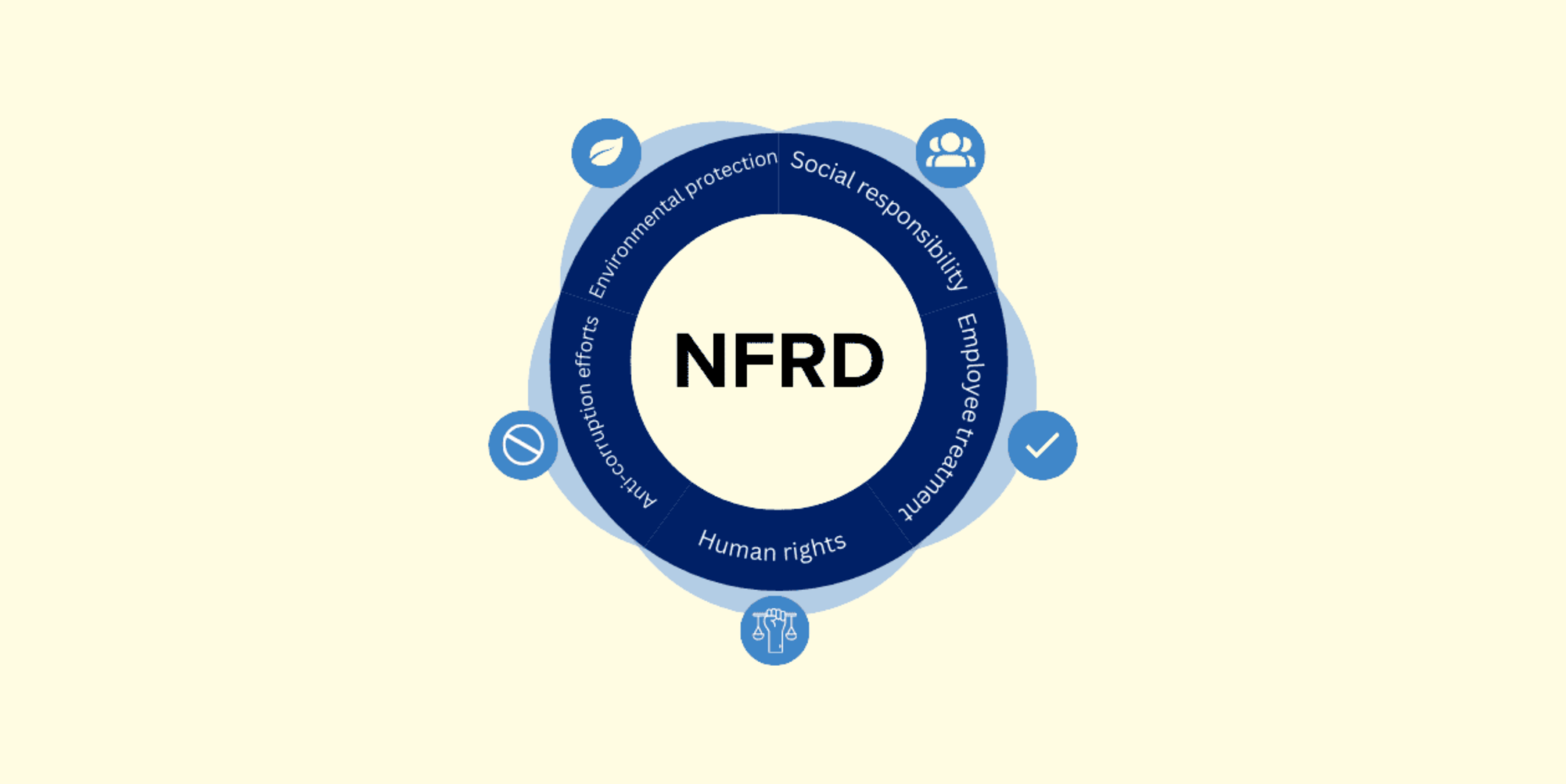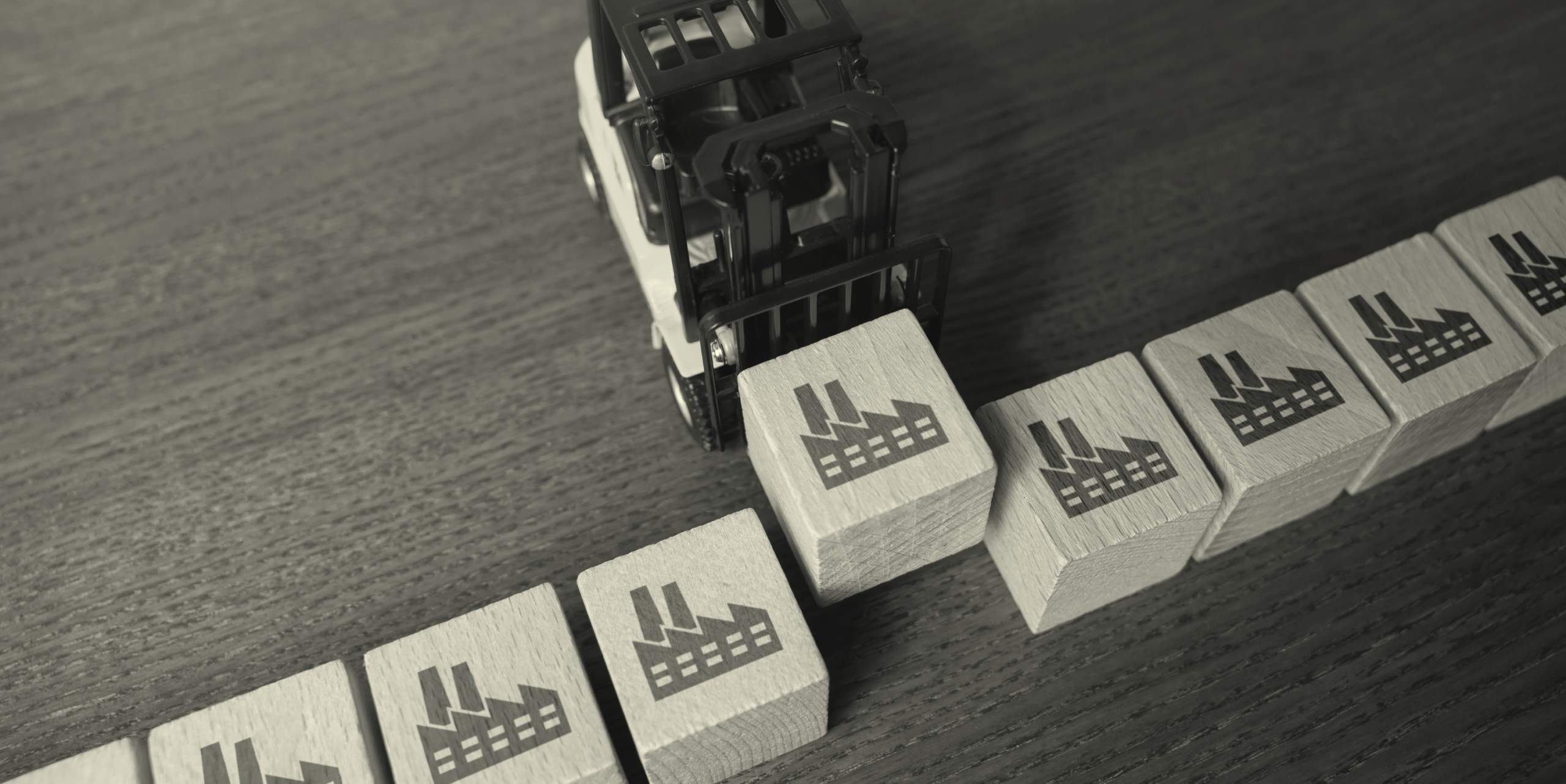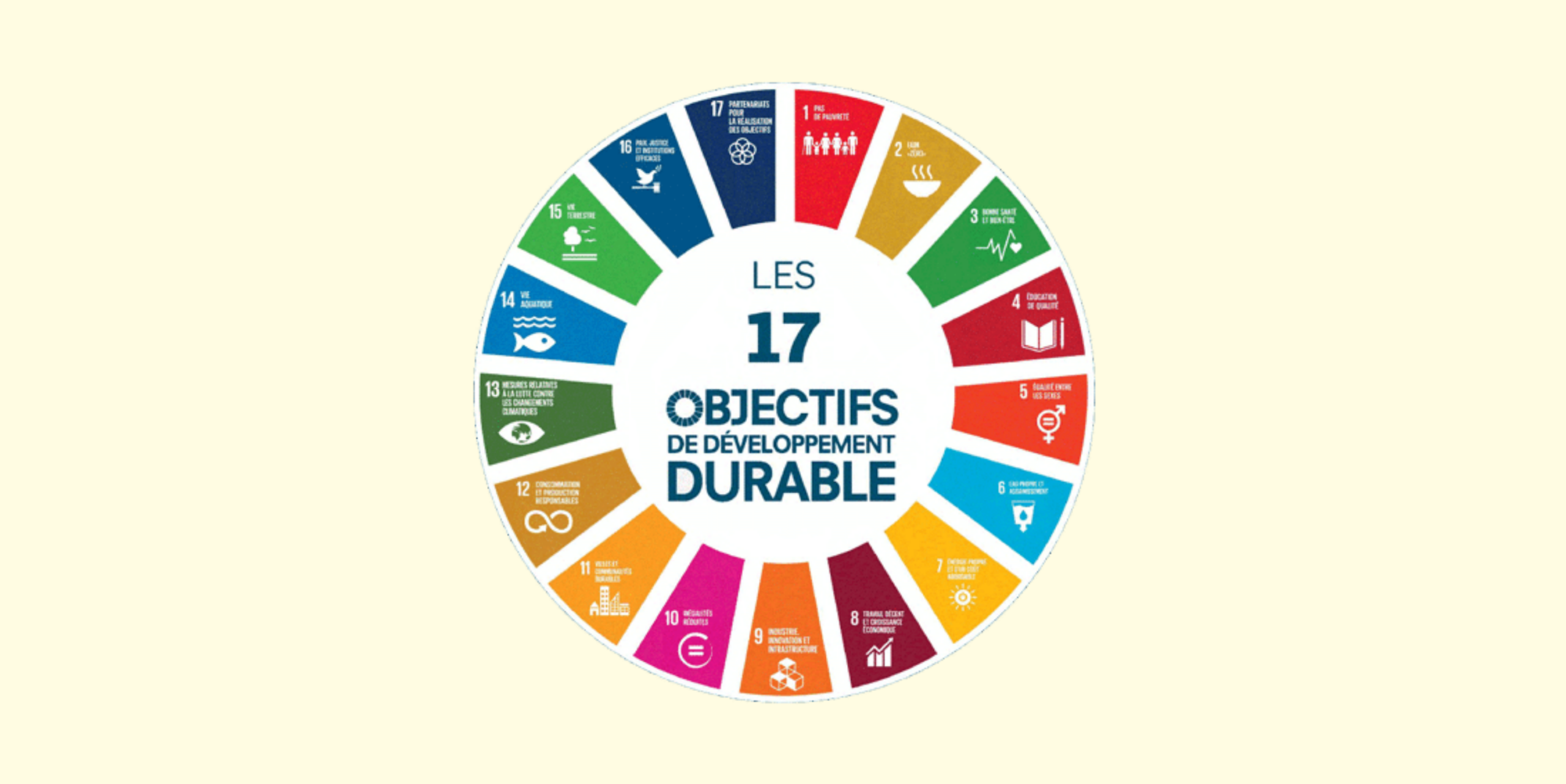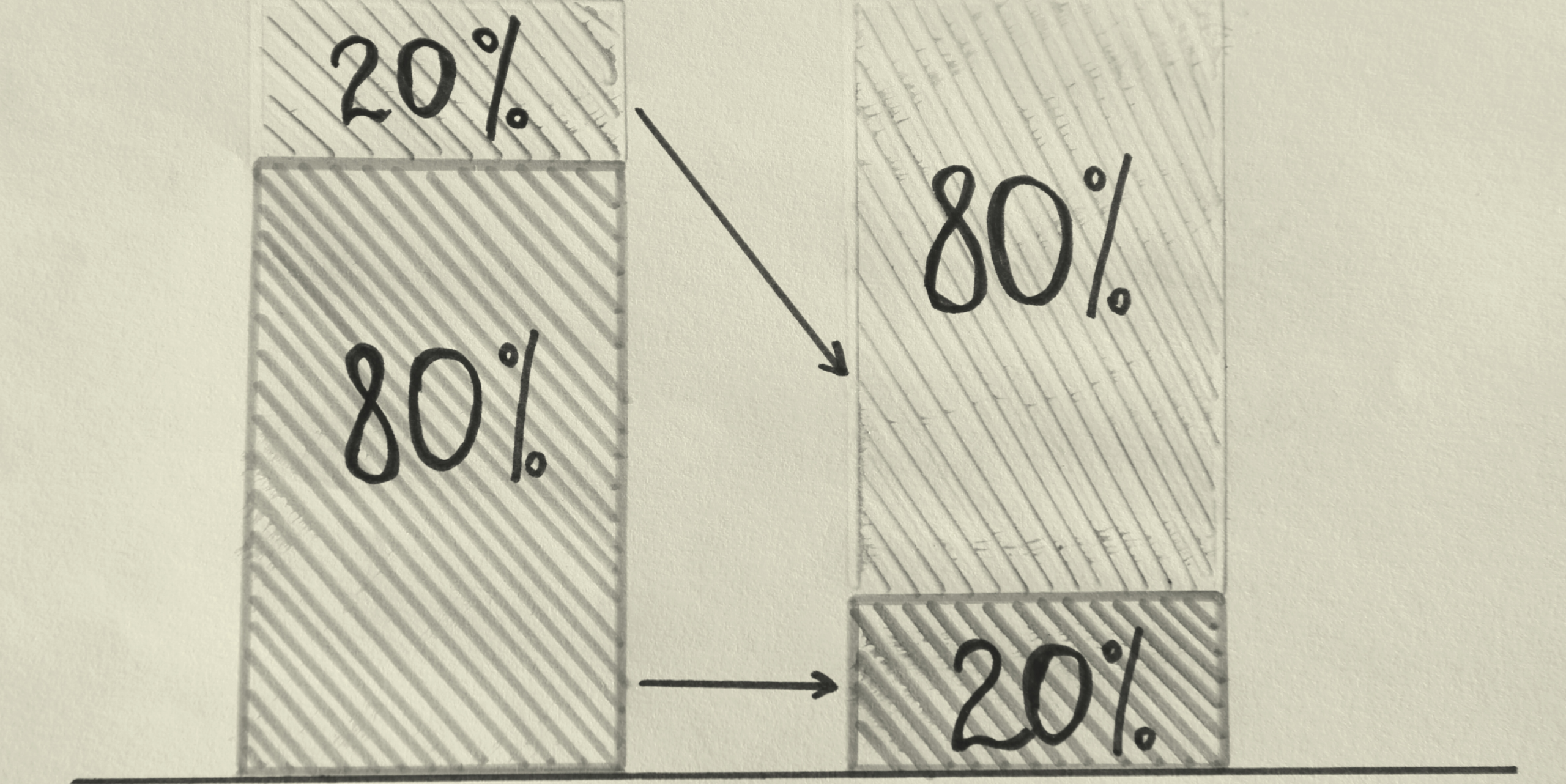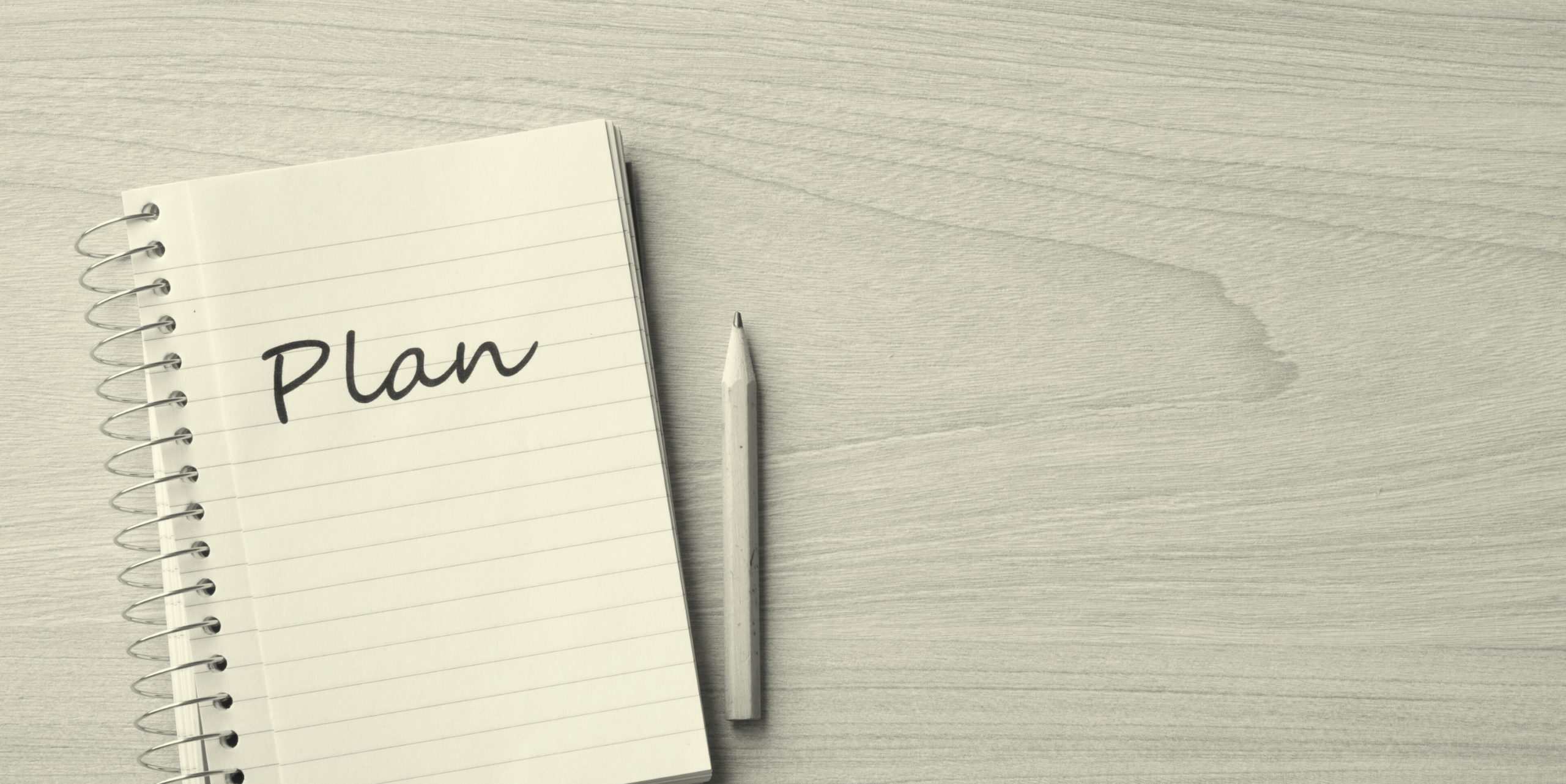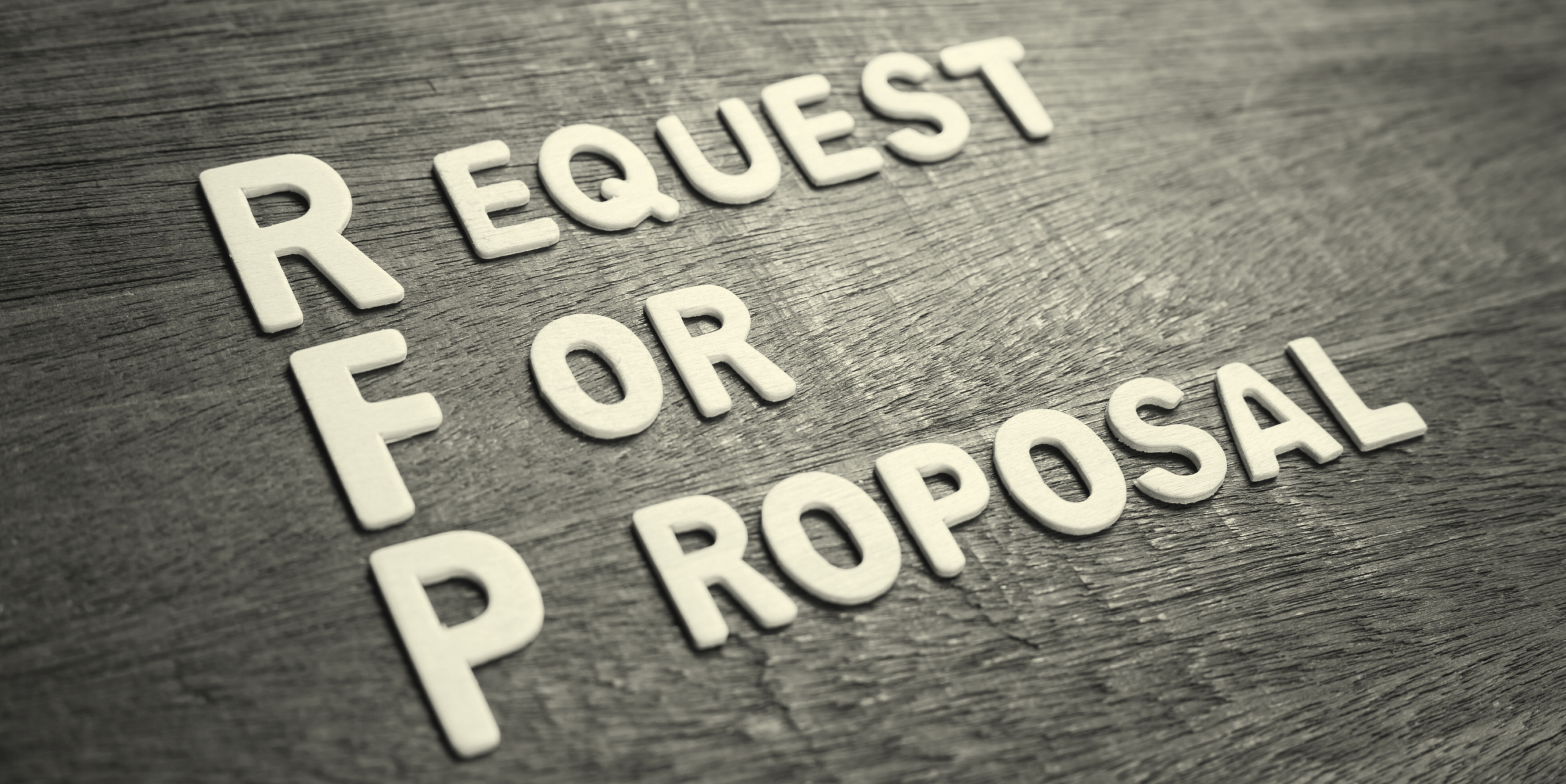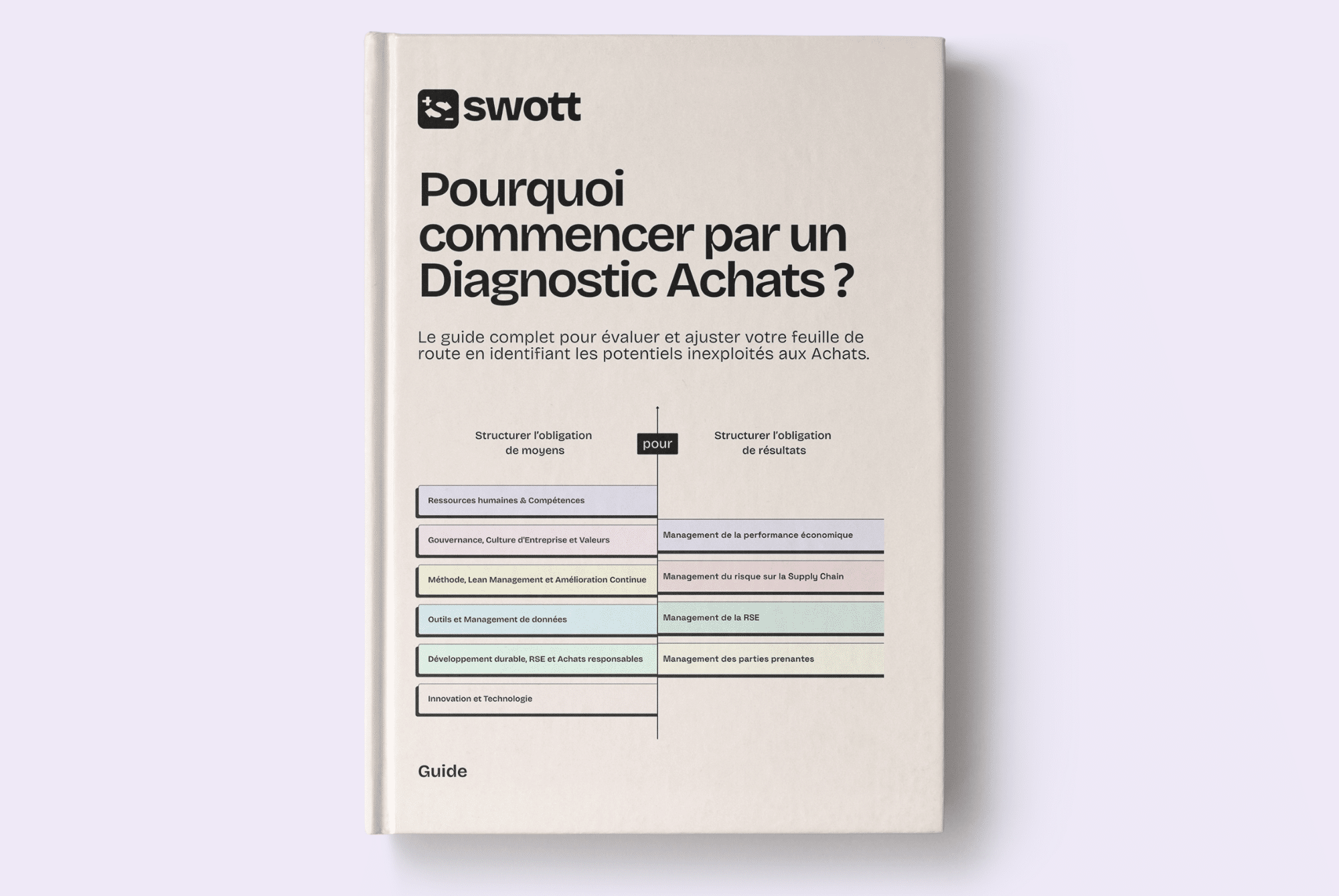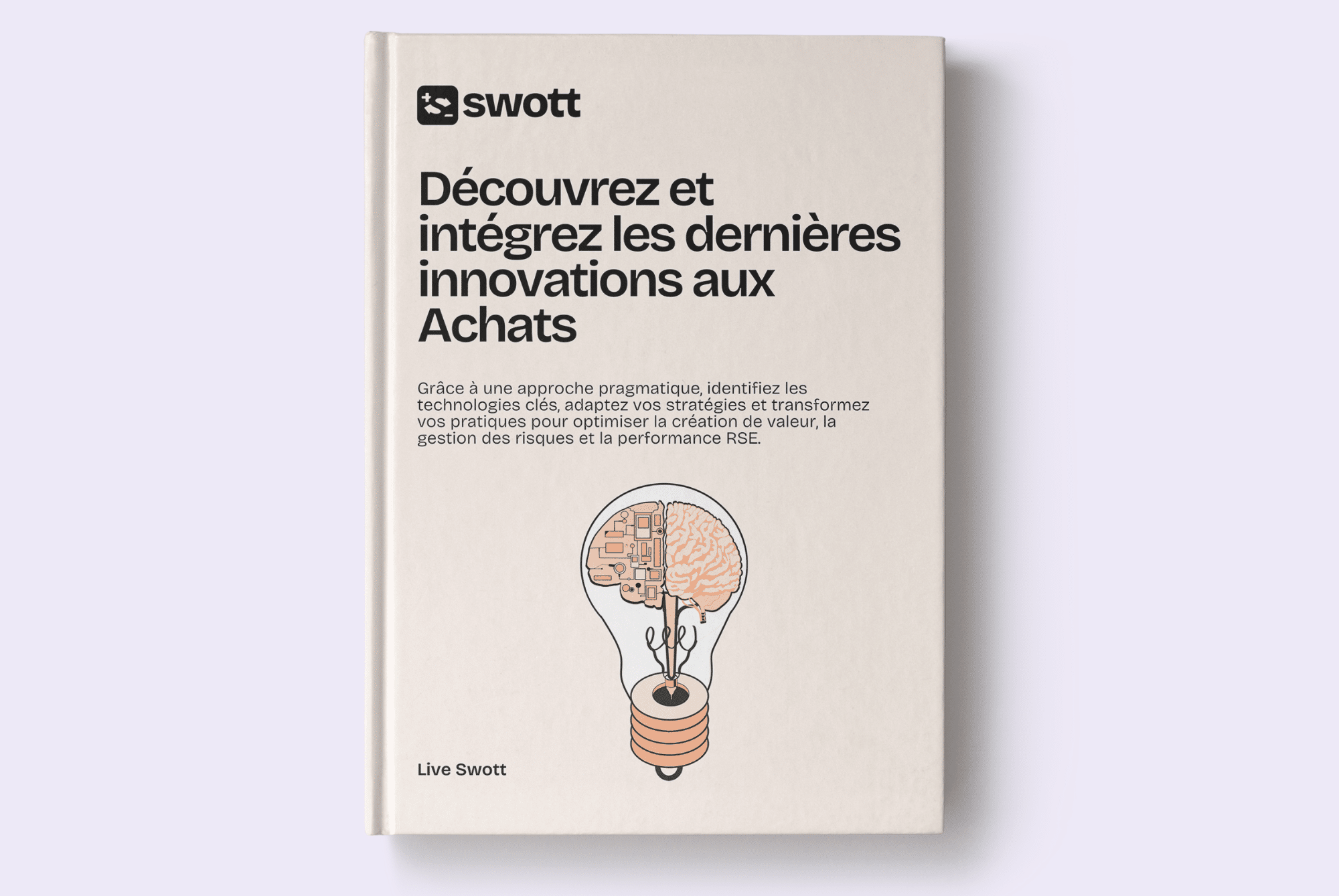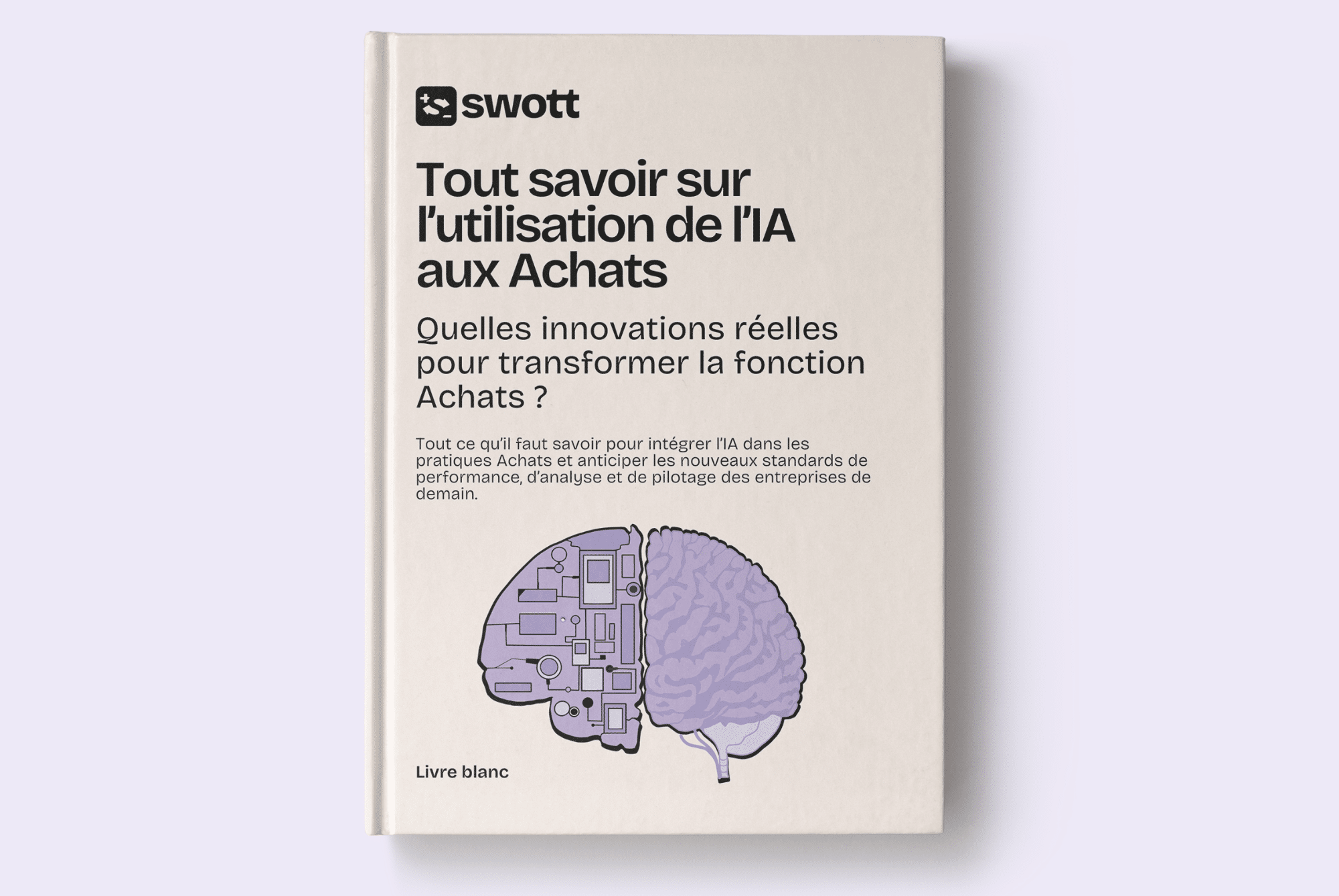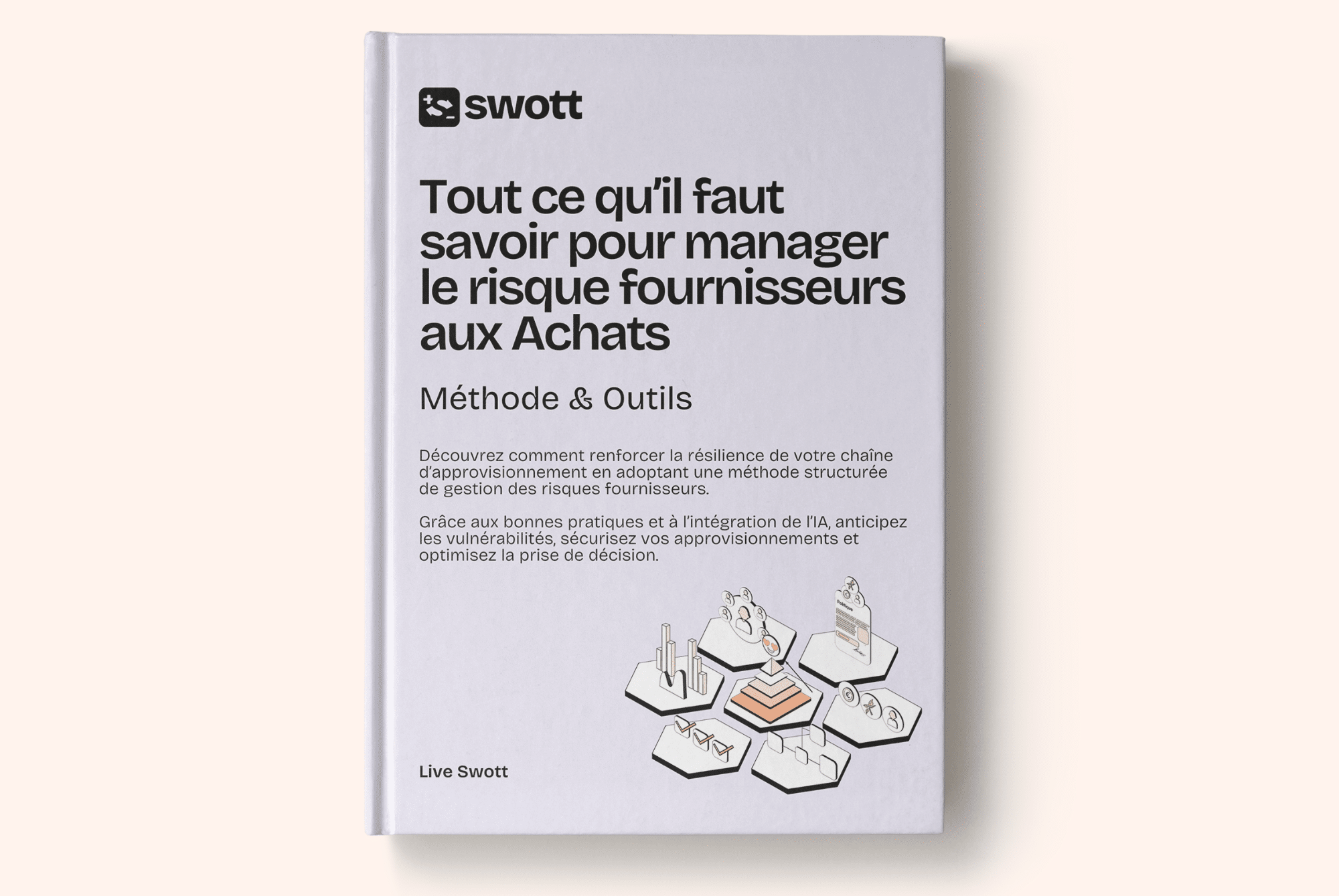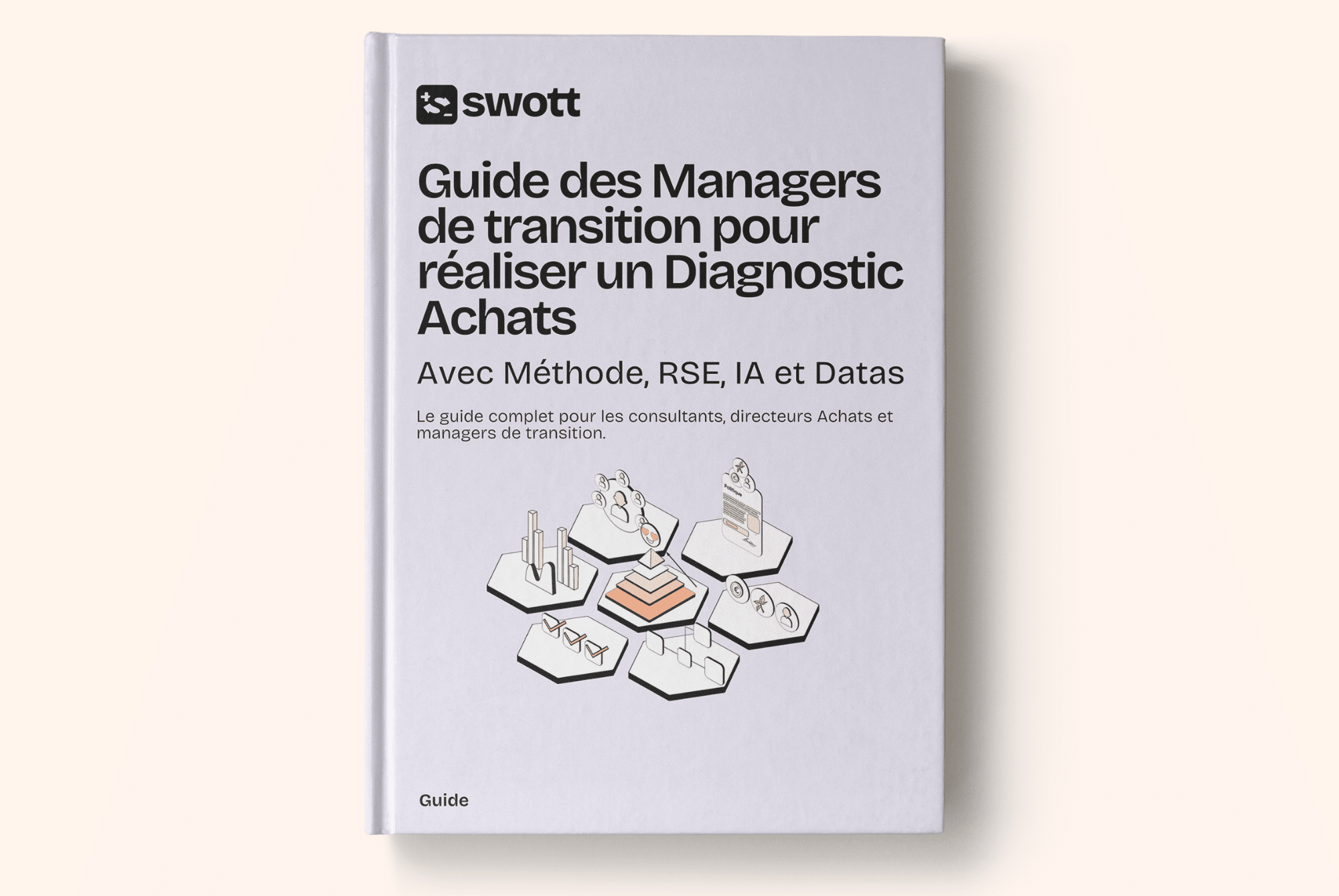Votre top 5
Nos articles
Catégorie
Les plus récents
Achats responsables et RSE
Formation Achats
Métiers et Employabilité
Non classé
Stratégie achats
Charger plus d'articles
Suivez nos dernières actualités en vous abonnant à notre newsletter
Notre boîte à outils
Besoin de conseils ?
Faites appel gratuitement à Swott pour bénéficier de conseils concernant votre projet de transformation vers un modèle plus durable et performant.

Envie de découvrir nos formations Achats Responsables ?
Téléchargez dès maintenant notre catalogue de formations
Télécharger le Catalogue